Partager la publication "L’armée libanaise face à sa plus grande épreuve depuis Taëf"
Ibrahim Al-Amine, 18 août 2025.– La récente décision du gouvernement concernant les armes de la résistance n’est pas une mesure administrative ordinaire à classer. Si certains au pouvoir peuvent le penser, il est clair que les exigences des États-Unis et de l’Arabie saoudite, et de ce qui sert les intérêts d’Israël, exigent plus qu’une simple mesure symbolique. Ce qui a été approuvé n’est que la première étape d’un plan plus vaste. Exiger que l’armée élabore un « plan » n’est pas une tactique dilatoire, comme certains l’ont imaginé, mais la première porte à ouvrir.
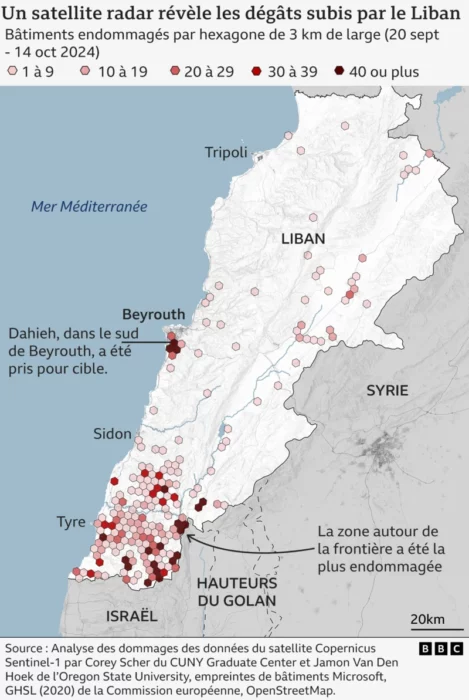 Le ministre de la Défense, Michel Mansi, et les dirigeants de l’armée n’ont pas pu empêcher le gouvernement de faire peser ce fardeau sur l’armée. L’opinion générale veut que l’armée obéisse simplement à l’autorité politique, et que tout refus violerait le droit public. Mais cette logique ne tient pas au Liban. Depuis les accords de Taëf de 1989, l’armée libanaise n’a jamais été une institution suivant aveuglément les directives politiques. Sa conduite au cours des 35 dernières années montre clairement ce qu’on peut et ne peut pas lui faire faire.
Le ministre de la Défense, Michel Mansi, et les dirigeants de l’armée n’ont pas pu empêcher le gouvernement de faire peser ce fardeau sur l’armée. L’opinion générale veut que l’armée obéisse simplement à l’autorité politique, et que tout refus violerait le droit public. Mais cette logique ne tient pas au Liban. Depuis les accords de Taëf de 1989, l’armée libanaise n’a jamais été une institution suivant aveuglément les directives politiques. Sa conduite au cours des 35 dernières années montre clairement ce qu’on peut et ne peut pas lui faire faire.
Après que les États-Unis et l’Arabie saoudite ont accepté le rôle dominant de la Syrie au Liban suite aux accords de Taëf, Hafez el-Assad s’est concentré sur la réorganisation des forces armées libanaises. Il a rapidement compris que des officiers bienveillants pouvaient unifier une armée fracturée par la guerre civile et en faire une institution nationale, à condition qu’elle reste à l’écart des querelles de la classe politique libanaise. L’objectif d’Assad n’était pas seulement de monopoliser le contrôle, bien qu’il y soit parvenu. Plus important encore, il savait que le Liban ne pourrait éviter une nouvelle immersion dans la guerre civile si l’armée n’était pas tenue à l’écart des conflits interconfessionnels.
Un groupe d’officiers a saisi l’occasion de reconstruire l’armée sur des bases professionnelles : donner aux soldats la confiance d’appartenir à une armée cohérente, mettre fin à la possibilité de nouveaux conflits internes et positionner l’armée comme une force qui ne ferait pas obstacle à la résistance armée contre Israël, qu’Assad lui-même soutenait.
Ce cadre a permis d’atteindre plusieurs objectifs. Elle limitait le pouvoir de l’ordre au pouvoir à quatre piliers confessionnels : un sunnite, un chiite, un druze et un chrétien. Elle exerçait un contrôle militaire et sécuritaire strict sur tout le territoire libanais, dissuadant toute faction de reprendre le comportement milicien du temps de guerre. Enfin, elle protégeait la résistance par un accord tacite selon lequel elle ne s’immiscerait pas dans les affaires de l’armée.
Indépendance à l’épreuve
Pendant des années, cette formule a préservé l’indépendance de l’armée libanaise vis-à-vis du pouvoir politique. En 1992, l’armée a refusé de se conformer à la décision israélienne de déporter des centaines de dirigeants palestiniens à Marj al-Zohour et a assuré les conditions nécessaires à leur retour. Lors des agressions israéliennes de 1993 et 1996, l’armée a résisté aux pressions occidentales et a joué son rôle dans les négociations qui ont abouti à l’accord d’avril 1996. Le message était clair : l’armée ne servirait pas simplement d’instrument aux ordres politiques. Lorsqu’Émile Lahoud est devenu président en 1998, il a rapidement constaté le peu de contrôle que la présidence, même elle, exerçait sur l’armée, non pas en raison des compétences du commandant Michel Suleiman, mais des règles établies par Assad.
Lorsque Suleiman lui-même a pris ses fonctions, l’armée a continué d’affirmer son indépendance, notamment lors des affrontements de mai 2008. Alors que des affrontements armés éclataient à Beyrouth après des décrets gouvernementaux visant la résistance, l’armée a refusé d’appliquer les décisions du gouvernement, les jugeant irréfléchies et illégitimes. La Syrie n’avait alors plus les mains libres au Liban. Mais Washington a compris l’intérêt d’une armée maintenue « neutre » face aux conflits internes du Liban et a commencé à cultiver son influence sur l’institution.
Michel Aoun, devenu président en 2016, a nommé Joseph Aoun commandant de l’armée. Il s’est vite senti frustré de voir ce commandant diriger l’armée avec le soutien des États-Unis comme bouclier, et non l’autorité présidentielle.
Le renversement imminent de Taëf
Le Liban traverse aujourd’hui une période critique, non pas parce que l’armée est à nouveau mise à l’épreuve, comme cela a été le cas à maintes reprises par le passé, mais parce que les dirigeants au pouvoir interprètent mal la situation. Le président actuel, Joseph Aoun, a souvent contourné le Premier ministre et son cabinet dans sa gestion des affaires de l’État, convaincu que les règles du jeu avaient changé. Il agit comme s’il ne devait son ascension à aucune puissance politique. Les changements internes, notamment les coups portés par l’entité israélienne à la résistance, et les bouleversements régionaux, notamment l’effondrement du régime de Bachar el-Assad en Syrie, l’ont encouragé à envisager un retour aux modes de gouvernance d’avant Taëf.
Son partenariat avec le Premier ministre Nawaf Salam est essentiellement tactique. Tous deux font avancer le programme des puissances qui les ont portés au pouvoir. Le véritable danger réside dans leur hypothèse selon laquelle l’armée peut désormais être déployée, sans hésitation, pour résoudre le « problème de la résistance ».
La responsabilité incombe donc aux dirigeants de l’armée et aux institutions de sécurité libanaises. S’ils ne font pas comprendre à la classe politique que leurs plans violent la gouvernance consensuelle établie à Taëf, ils risquent d’être entraînés dans la crise la plus grave que le Liban ait connue depuis 1975.
On dit souvent que le système confessionnel libanais possède une vertu indéniable : il empêche un coup d’État militaire. N’importe quelle faction importante peut se rebeller contre l’armée et la diviser, menaçant ainsi la survie de l’institution. Les avertissements concernant la division ou la destruction de l’armée si elle était contrainte à un affrontement fomenté par les fous des États-Unis, de l’Arabie saoudite et d’Israël ne constituent pas des menaces politiques. Ce sont des lectures logiques, réalistes et fondées de l’histoire du Liban. Quiconque pense le contraire risque de répéter les erreurs les plus dangereuses du pays.
Article original en anglais sur Al-Akhbar / Traduction MR / Première version en arabe ICI.