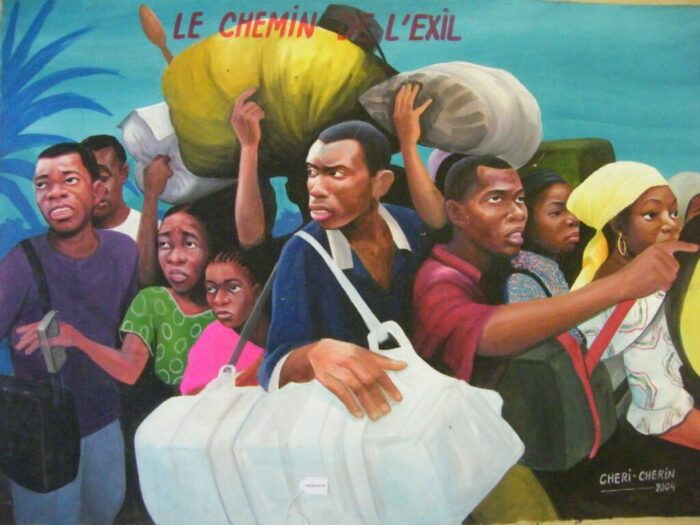Partager la publication "Retrouvons nos diamants perdus : sixième lettre d’information (2025)"
Vijay Prashad, 6 février 2025. Chers amis, Salutations du bureau de l’Institut Tricontinental de recherche sociale.
Donald Trump a fait un retour fracassant à la Maison Blanche. Son personnel a jeté sur son bureau décret sur décret, qu’il a signés en fanfare avant de prendre le téléphone pour aboyer ses ordres aux Danois, aux Panaméens et aux Colombiens, exigeant ceci, cela, et encore autre chose, celle-ci, celle-là, les choses qu’il estime méritées par les États-Unis.

Umar Rashid (États-Unis), Je rêvais quand j’ai écrit ceci. Pardonnez-moi si je m’égare. Le chant des quatre compagnons commence au Sahel en présence des marabouts. Pandore vient du nord. L’Harmattan s’approche et appelle les tempêtes et les guerres à venir, 1799, 2023.
Dans l’histoire de Trump, les États-Unis ont connu un âge d’or. Il est aujourd’hui le symbole de leur inquiétude. Son slogan Make America Great Again » (« rendons sa grandeur à l’Amérique »), ne cache pas l’inquiétude que suscite l’effondrement du pays : rendez-lui sa grandeur dit-il, parce que les États-Unis l’ont perdue, et qu’ils la méritent et que je vais la leur rendre. Ses partisans savent qu’au moins il a été honnête dans son évaluation du déclin. Beaucoup peuvent le constater sur leur compte bancaire, trop dégarni pour nourrir leur famille, et le voir dans les infrastructures délabrées qui les entourent. La méthamphétamine en cristaux et le fentanyl engourdissent l’horrible douleur tandis que les nouvelles chansons des États-Unis se lamentent de l’incertitude, comment même leurs « rêves s’étiolent ». Un avion de ligne entre en collision avec un hélicoptère militaire, et Trump monte sur le podium de la salle de de presse de la Maison Blanche et attribue l’accident à la promotion de la diversité dans les recrutements. Les génies doivent être aux commandes du contrôle du trafic aérien, dit-il. Mais l’homme qui à son poste cette nuit-là faisait le travail de deux personnes en raison des coupes impitoyables entamées des décennies plus tôt, avec la suppression en 1981 par Ronald Reagan du syndicat des contrôleurs aériens Professional Air Traffic Controllers Organisation (PATCO). C’est Reagan qui, le premier, a lancé au monde le slogan de Trump, Make America Great Again.
La réalité est laide. Il est bien plus facile de se complaire dans la fantaisie. Trump est le magicien qui manie cette fantaisie. Tout s’est détérioré, pas à cause de l’attaque contre les syndicats, de l’austérité qui a suivi, ou de l’essor des technocrates dont le bien-être social est scandaleux et qui sont en grève fiscale depuis des décennies. La fantaisie de Trump est incohérente. Sinon, comment Trump aurait-t-il pu élever Elon Musk, symbole du déclin, au rang d’agent de la transformation d’un nouvel âge d’or ?
Il y a de la folie, oui. Mais l’impérialisme a toujours été teinté de folie. Des centaines de millions de personnes, des Amériques à la Chine, ont été tuées ou soumises pour qu’une petite partie du monde, l’Atlantique Nord, puisse s’enrichir. C’est de la folie. Et cela a fonctionné. Cela continue de fonctionner, dans une certaine mesure. La structure néocoloniale du capitalisme reste intacte. Lorsqu’un pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine ou des îles du Pacifique tente d’affirmer sa souveraineté, il est défenestré. Coups d’État, assassinats, sanctions, vol de richesses, autant d’instruments utilisés pour mettre à bas toute tentative de souveraineté. Et cette structure néocoloniale se maintient grâce à la division internationale de l’humanité : certains continuent à se croire supérieurs aux autres. Dans notre étude de Tricontinental Hyper-Impérialisme, nous avons montré que les pays de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) représentent plus de 74 % des dépenses militaires mondiales, alors que la Chine représente 10 % et la Russie 3 % de ces dépenses. On entend pourtant dire que la Chine et la Russie constituent les menaces, et non l’OTAN, qui, dirigée par les États-Unis, est en fait l’institution la plus dangereuse au monde. L’OTAN a détruit des pays entiers (Yougoslavie, Afghanistan, Libye, par exemple) et menace maintenant, avec légèreté, d’attaquer des pays dotés d’armes nucléaires (la Chine et la Russie). Trump clame dans le vent :
Nous voulons le canal de Panama. Nous voulons le Groenland. Nous voulons l’appeler le Golfe d’Amérique.
Pourquoi ces demandes seraient-elles surprenantes ? Le Panama faisait partie de la République de Grande Colombie depuis 1821, lorsque la région, sous la direction de Simón Bolívar (1783–1830), se sépara de l’empire espagnol. L’intérêt pour la construction d’un canal à travers l’isthme de Panama était de raccourcir les routes maritimes entre les océans Atlantique et Pacifique et d’éviter le long voyage contournant l’Amérique du Sud. Cet intérêt s’est développé au début du 20ème siècle, des décennies après la partition de la Grande Colombie conduisant en substance à ce qui constitue aujourd’hui le Panama, le Venezuela, la Colombie et l’Équateur. En 1903, des intrigues de la France et des États-Unis, ainsi qu’une intervention de la marine étasunienne, ont conduit à la sécession du Panama de la Colombie. Le nouveau gouvernement panaméen a alors donné aux États-Unis la zone du canal, impliquant un contrôle total de l’isthme de 1903 à 1999, date à laquelle les États-Unis ont « rendu » le canal à la juridiction panaméenne. Il faut se rappeler qu’en 1989, lorsque Manuel Noriega, ancien atout de la CIA, ne leur convenait plus, les États-Unis ont envahi le Panama, se sont emparés de Noriega et l’ont incarcéré à Miami, en Floride, avant de le libérer pour qu’il décède à Panama City en 2017. L’actuel président du Panama, José Raúl Mulino, est entré en politique en rejoignant le gouvernement de Guillermo Endara, qui a prêté serment sur une base militaire américaine en 1989, au moment où Noriega était emmené en Floride. Ces hommes connaissent bien la posture de propriétaire des États-Unis vis-à-vis de leur territoire. Ce n’est pas seulement Trump qui « veut » le canal de Panama, c’est toute l’histoire du traitement de l’Amérique latine par les États-Unis, de la doctrine Monroe à ce jour, cristallisée, qui se résume en une phrase : « nous voulons le canal de Panama ».
La mémoire est fragile. Elle est sans cesse façonnée par des demi-vérités et des dissimulations. Sous la réalité superficielle des événements, se cachent des structures plus profondes qui influencent notre vision des choses. Les vieilles idées coloniales de bienveillance occidentale et de sauvagerie indigène éclatent au grand jour au moment de l’interprétation.
En 2004, un an après le début de la guerre d’agression des États-Unis et de leurs alliés contre l’Irak, le Secrétaire Général de l’ONU, Kofi Annan, a été interviewé par Owen Bennett-Jones de la BBC. Une partie de cette conversation portait sur la guerre contre l’Irak :
Owen Bennett-Jones (OBJ) : Vous ne pensez donc pas que la guerre était juridiquement fondée ?
Kofi Annan (KA) : J’ai clairement dit qu’elle n’était conforme ni aux décisions du Conseil de Sécurité, ni à la Charte des Nations Unies.
OBJ : Elle était illégale ?
KA : Oui, si vous voulez.
OBJ : Elle était illégale ?
KA : Oui, j’ai indiqué qu’elle n’était pas conforme à la Charte des Nations Unies. De notre point de vue et du point de vue de la Charte, c’était illégal.
Si cette guerre était illégale, une guerre d’agression, alors il aurait dû y avoir des conséquences. C’était censé être l’objectif du Tribunal de Nuremberg de 1945-46. La surmortalité due à cette guerre dépasse désormais largement le million de personnes, avec des millions d’autres impactées négativement par la destruction des infrastructures. Si cette guerre avait été traitée comme une guerre d’agression, ses architectes (George W. Bush et Tony Blair) pourraient-ils faire le tour du monde avec leurs sourires à mille dollars et leurs costumes sur mesure ? Ils n’ont pas fait l’objet de mandats de la Cour Pénale Internationale, et leurs pays n’ont pas été traduits devant la Cour Internationale de Justice pour y être entendus. Bush a été confronté aux chaussures de Muntadhar al-Zaidi en 2008 lorsqu’il s’est rendu à Bagdad, tandis que Blair, lors de l’enquête sur la guerre en Irak en 2012, a été surpris par David Lawley-Wakelin, qui est sorti de derrière un rideau et a déclaré : « Cet homme devrait être arrêté pour crimes de guerre ». Ni les chaussures n’ont atteint Bush, ni Blair n’a été arrêté. Aujourd’hui, Blair s’est transformé en artisan de la paix et Bush s’est forgé une image de vieil homme d’État.
Dans son discours d’ouverture de trois heures au Tribunal de Nuremberg en 1945, le juge Robert Jackson a déclaré :
« La civilisation se demande si la justice est tellement lente qu’elle est totalement impuissante face à des crimes de cette ampleur, commis par des criminels d’une telle envergure. Elle ne s’attend pas à ce que vous puissiez empêcher la guerre. Elle attend cependant de vos actions juridiques qu’elles mettent les forces du droit international, ses préceptes, ses interdictions et, surtout, ses sanctions, du côté de la paix, pour que les hommes et les femmes de bonne volonté, partout, puissent « vivre, sans la permission de quiconque, sous la protection de la loi » ».
Le vers cité par le juge Jackson est tiré du poème de Rudyard Kipling The Old Issue (1899), qui était très lu dans les années 1940. Deux ans avant le discours de Jackson, le Premier ministre britannique Winston Churchill avait cité le même poème dans son discours à l’Université de Harvard pour souligner qu’il existait, selon lui, « des conceptions communes de ce qui est juste et décent » qui confèrent aux humains « un sentiment profond de justice impartiale… ou comme le dit Kipling, le droit de « vivre, sans la permission de quiconque, sous la protection de la loi » ». La conception de Churchill de ce qui est « juste et décent » est résumée lorsque, vingt ans plus tôt, à propos de la rébellion kurde dans le nord de l’Irak, il écrivait qu’il était « tout à fait favorable à l’utilisation des gaz toxiques contre des tribus non civilisées ».
Il serait intéressant de passer du cas de Nuremberg, relativement bien connu, à ceux, moins connus, des procès de crimes de guerre à Tokyo. Là, le tribunal a décidé de punir les dirigeants militaires dont les troupes ont commis des atrocités. Le général Tomoyuki Yamashita commandait le quatorzième groupe armé de l’armée impériale japonaise, qui opérait principalement aux Philippines. Après sa reddition, le général Yamashita a été accusé d’avoir permis à ses troupes de commettre des atrocités contre des civils et des prisonniers de guerre. Il a été exécuté le 23 février 1946. Personne n’a prétendu que le général Yamashita avait personnellement infligé des souffrances à qui que ce soit : il a été accusé de « responsabilité de commandement ». En 1970, le principal procureur militaire à Nuremberg, Telford Taylor, a fait remarquer qu’« il n’y avait pas d’accusation selon laquelle le général Yamashita avait approuvé, encore moins ordonné ces barbaries, et aucune preuve qu’il en avait connaissance, si ce n’est la déduction qu’il devait savoir en raison de leur ampleur ». Il a été pendu parce que, comme l’a noté le tribunal de Tokyo, le général Yamashita « n’a pas assuré un contrôle efficace de ses troupes comme l’exigeaient les circonstances ». Taylor a écrit ces mots dans son livre Nuremberg and Vietnam: An American Tragedy, aujourd’hui largement tombé dans l’oubli, dans lequel il plaidait non seulement pour poursuivre les politiciens et généraux américains, mais aussi les aviateurs américains ayant bombardé des cibles civiles dans le nord du Vietnam parce qu’ils avaient participé au crime de « guerre d’agression », tel que défini à l’époque de Nuremberg.

Mohammed al-Hawajri (Gaza, Territoire Palestinien Occupé), Sans titre, de la série Été à Gaza (2017).
Mi-janvier, Alex Morris de Declassified UK a confronté le général israélien Oded Basyuk alors qu’il s’apprêtait à rencontrer les hauts responsables du Ministère de la Défense britannique et du Royal United Services Institute. Le général Basyuk a supervisé le génocide des Palestiniens et fait l’objet d’une enquête pour crimes de guerre par la Cour Pénale Internationale. Pourtant, le voilà dans les rues de Londres, en route pour rencontrer les hauts fonctionnaires militaires britanniques. Les mandats d’arrêt de la CPI contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont été écartés par la Pologne et les États-Unis, réduisant à néant les principes des Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo. Malheureusement, les principes des Nations Unies pour combattre l’impunité (2005) ne sont pas juridiquement contraignants.
Le sang coulera à flots sur les avenues de certaines parties du monde. Le champagne remplira les verres dans d’autres.
En 1965, pendant la guerre entre l’Inde et le Pakistan, Faiz Ahmed Faiz écrivit un poème intitulé Blackout :
Depuis que nos lumières ont été éteintes,
Je cherche un moyen de voir ;
Mes yeux sont perdus, Dieu sait où.
Toi qui me connais, dis-moi qui je suis,
Qui est un ami, et qui est un ennemi.
Une rivière meurtrière s’est déversée
Dans mes veines ; la haine y palpite.
Sois patient ; un éclair lumineux viendra
D’un autre horizon, comme la main blanche
De Moïse, avec mes yeux, mes diamants perdus.
Retrouvons nos diamants perdus.
Chaleureusement,
Vijay
Article original en anglais : Tricontinental Institute for Social Research – The Sixth Newsletter (2025) / Traduction Chris & Dine